Revue Musicorum

Des formes contemporaines de théâtre musical européen, c’est sans doute la comédie musicale britannique qui reste aujourd’hui le genre le plus vivant. Structuré par des institutions musicales héritées des siècles précédents, cet univers en perpétuel renouvellement continue à faire les beaux jours de la scène londonienne et internationale. Longtemps méprisée par la critique universitaire, la comédie musicale britannique offre pourtant un champ fécond aux recherches d’histoire sociale, culturelle et esthétique.
C’est justement le projet de ce volume que d’explorer les différents enjeux d’un genre à la fois ambitieux et populaire, aux problématiques multiples et pourtant spécifiques qui dessinent les contours d’un corpus marqué par la plus grande diversité. Ce volume rassemble ainsi quatorze études qui attestent toutes de la vitalité et de la pérennité du genre. Relevant d’une forme théâtrale à la fois savante et populaire, classique et moderne, mais surtout éminemment vivante, la comédie musicale britannique continue d’exercer son incroyable pouvoir de fascination.
***
Out of contemporary forms of musical theatre, the British musical comedy is probably the only genre that has remained truly and genuinely alive. Structured by musical institutions inherited from the past, this ever-evolving universe still graces the London and the international stage today. Long despised by Academia, the British musical comedy nevertheless affords vast areas of research for scholars interested in social, cultural and aesthetic history.
It is precisely the aim of the present volume to explore the various issues raised by a dramatic genre that, both popular and demanding, deals with wide-ranging and far-reaching problems that have given this multi-faceted corpus its unity and specificity. The fourteen studies collected in this volume all testify to the vitality of this highly perennial genre. A theatrical form that is both highbrow and middlebrow, modern and classical, the apparently immortal British musical comedy still wields its incredible power of fascination.
Quatrième de couverture
La Comédie Musicale Britannique aux XIXème et XXème siècles

À partir des années 1960, l’opérette et l’opéra « léger » dans le style du XIXème siècle, représentés en France par Adolphe Adam, Auber, etc., et en Allemagne surtout par Albert Lortzing ne sont plus vivants. Quelques compositeurs et quelques œuvres célèbres font néanmoins toujours partie du répertoire : Jacques Offenbach représente l’opérette française, Johann Strauss l’opérette viennoise, au-delà des frontières de leurs pays d’origine respectifs. Dans les pays germanophones, les œuvres de Franz Lehár ou Emmerich Kálmán ont survécu, aussi bien que quelques opérettes de compositeurs aujourd’hui moins connus comme Franz von Suppé (Die schöne Galathee), Carl Millöcker (Der Bettelstudent), Carl Zeller (Der Vogelhändler), Paul Lincke (Frau Luna), etc. Si les théâtres parisiens ont longtemps négligé le théâtre musical de Charles Lecocq, Edmond Audran, Messager ou Reynaldo Hahn, leurs opérettes les plus populaires (La Fille de madame Angot et Giroflé-Girofla de Lecocq, La Mascotte d’Audran, Véronique de Messager, Ciboulette de Hahn…) ont été montées plus ou moins régulièrement en province.
La situation en Angleterre (et aux États-Unis) est différente: c’est le tandem William Schwenck Gilbert et Arthur Sullivan qui, avec leurs Savoy Operas, occupent la place qu’Offenbach tient en France, et Johann Strauss dans le monde germanophone. Leurs œuvres figurent régulièrement au programme de l’English National Opera (ENO), qui a présenté, au mois de février 2018, une nouvelle mise en scène de Iolanthe. Tout de même, le couple est absent du programme de l’ENO pour la saison 2018/19 (on annonce, par contre, une nouvelle production de La Veuve Joyeuse de Franz Lehár).
The National Gilbert & Sullivan Opera Company monte tous les ans plusieurs spectacles, qui sont joués pendant une tournée en province. La compagnie participe aussi au Gilbert & Sullivan Festival, qui a lieu tous les ans à Harrogate (North Yorkshire) ; en 2018, les six pièces montées par la troupe y ont eu seize représentations au total. En outre, 26 compagnies d’amateurs ou de semi-professionnels (dont plusieurs drama groups d’universités britanniques) ont présenté chacune un spectacle.
C’est surtout grâce à des troupes d’amateurs que le théâtre de Gilbert et Sullivan, et de quelques-uns de leur contemporains, est toujours vivant en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Évidemment, le niveau musical et théâtral des représentations qu’elles donnent est assez inégal. Les mises en scène dans les théâtres subventionnés et les enregistrements (audio ou vidéo) faits par des chanteurs ou acteurs professionnels sont assez nombreux pour les pièces les plus populaires de Gilbert et Sullivan, mais beaucoup plus rares pour les œuvres de Sidney Jones, Lionel Monckton ou Edward German. Pour le grand public, qui ne sait pas lire une partition, il est donc difficile de se faire une idée des comédies musicales édouardiennes et de l’entre-deux-guerres. Les enregistrements de la Geisha ou du Poisoned Kiss sont des exceptions qui confirment la règle.
Il en va de même pour les prédécesseurs de G&S. Non seulement James Robinson Planché, mais aussi les créateurs de l’opéra « léger », sinon comique, en Angleterre – Michael Balfe (The Bohemian Girl, 1843), Vincent Wallace (Maritana, 1845) ou Julius Benedict (The Lily of Killarney, 1862) – ont été peu à peu oubliés au cours du XXème siècle.
Probablement, l’avènement du musical (play) à Broadway et au West End de Londres y est pour quelque chose. L’histoire de l’opérette continentale finit après la Deuxième Guerre mondiale ou dans les années 1960 au plus tard. Dès lors, le répertoire est stable, les pièces favorites du public reflètent une société qui n’est plus. Cependant, les chefs-d’œuvre d’Offenbach, de Johann Strauss ou de Lehár ne tombent pas dans l’oubli, ils sont montés régulièrement (dans des versions plus ou moins remaniées), et les spectateurs goûtent leur charme nostalgique. Mais, chaque saison apporte un nombre considérable de musicals nouveaux, dont les plus réussis répondent (directement ou indirectement) aux préoccupations de leur public. Les théâtres commerciaux reviennent rarement à des pièces plus anciennes, bien que leurs qualités musicales soient indéniables. Ce sont plutôt des troupes d’amateurs qui mettent en scène Kiss Me, Kate ou Brigadoon, tout aussi bien que The Arcadians ou The Geisha.
Depuis quelque temps, la critique universitaire semble s’intéresser de plus en plus au théâtre musical, qui offre un champ fécond aux recherches d’histoire sociale et culturelle. Les études consacrées aux théâtres gérés par Offenbach, à des chanteurs / chanteuses et acteurs /actrices tels que Hortense Schneider ou Alexander Girardi, à la législation sur le théâtre et au rôle de la censure, etc., foisonnent. Au XIXème siècle, l’opérette naît à Paris, et se développe à Paris, Vienne et Berlin. Or, ces trois capitales se distinguent considérablement l’une de l’autre en ce qui concerne l’organisation de la vie théâtrale, les restrictions imposées par le gouvernement, la stratification sociale du public, etc., toutes ces différences rendant les comparaisons entre les trois cultures tout à fait éclairantes.
Londres est évidemment le quatrième centre du théâtre musical dont il faut tenir compte même si, avant et après Gilbert et Sullivan, le rayonnement international des comédies musicales et des opéras légers anglais est moins considérable que celui des opérettes françaises ou viennoises. Londres n’est pas seulement le foyer d’une tradition (musico-)théâtrale autochtone qui peut servir de repoussoir au théâtre continental, mais aussi le carrefour d’influences italiennes, françaises, viennoises et, bien sûr, américaines. La capitale britannique joue un rôle des plus importants dans le processus de l’internalisation de l’opérette et de la comédie musicale.
Dans ce volume, nous avons rassemblé quatorze études couvrant l’histoire de la comédie musicale britannique du début du XIXème siècle jusqu’à nos jours. On y trouve, entre autres, deux articles sur Arthur Sullivan, trois sur la naissance et l’apogée de la comédie musicale édouardienne, et cinq sur des musicals importants créés à partir des années 1950. Tandis qu’au XIXème siècle et au début du XXème, la créativité des auteurs s’exerce dans le cadre de genres assez bien définis, à partir des années 1960 au plus tard, les œuvres acquièrent une physionomie plus individuelle et redessinent des catégories génériques de plus en plus complexes et différentiées, les traits communs aux pièces analysées semblant moins importants que les différences entre elles.
Notre volume s’ouvre ainsi tout naturellement avec la contribution de Marion Linhardt, laquelle s’intéresse surtout à la partie musicale des extravaganzas de Planché, négligée jusqu’ici par les chercheurs. Avant 1843, dans les pièces jouées dans les minor theatres, il faut un nombre assez élevé d’airs ou de couplets. Comme dans le vaudeville français, les auteurs font une compilation de mélodies préexistantes, avec de nouveaux textes appropriés à la situation dramatique. Planché met à profit les opéras en vogue et les opéras anglais du XVIIIème siècle, il utilise des mélodies populaires et aussi des ballades ou songs sentimentaux chantés dans les concerts. À partir des années 1840, il a recours aux danses à la mode et aux minstrels songs américains. Le public des extravaganzas ne vient pas pour découvrir de la musique nouvelle, mais pour réentendre ses mélodies favorites.
Kurt Gänzl retrace quant à lui la vie et la carrière des « British Blondes », c’est-à-dire des trois chanteuses qui, en 1868, ont accompagné Lydia Thompson aux États-Unis pour y introduire le « burlesque » britannique. Pauline Markham (1843-1919) a fait une carrière assez brillante, et Gänzl a rassemblé une documentation abondante qui lui permet de suivre sa biographie pas à pas. Il l’appelle « the nineteenth-century Marilyn Monroe », tout en convenant que la comparaison n’est pas tout à fait adéquate. Les deux compagnes de Pauline ont fait moins de bruit, et il est plus difficile de suivre leurs traces : Lisa Weber (ca. 1842-1887) n’a connu le succès que de 1868 à 1870, quand elle faisait partie des « British Blondes ». Ada Harland (1846-1924), qui brillait surtout par la danse, s’est mariée en 1870 et a passé le reste de sa vie oubliée et (probablement) heureuse.
Consacré à l’un des plus grands succès de G&S, The Pirates of Penzance, l’article de Joël Richard s’attache à démonter les codes et les mécanismes de la satire et de la parodie, montrant à quel point les racines de la comédie musicale britannique doivent autant au regard décapant des deux auteurs sur les vieilles institutions nationales qu’à l’analyse des problèmes sociaux et sociétaux de leur époque. Mais c’est surtout de questions esthétiques que traite le texte, tout aussi bien dans la réflexion qui y est menée sur le concept même d’intrigue ou de non-intrigue que dans la manière dont librettiste et compositeur détournent, tout en feignant de s’y adonner, les diverses conventions littéraires, théâtrales et musicales dont se nourrit leur ouvrage. La « piraterie » dont il s’agit dans The Pirates of Penzance se retrouve ainsi dans la présentation loufoque et chaotique de l’histoire, dans l’irrévérence avec laquelle sont vues la tradition et les solides valeurs victoriennes, ainsi que dans l’irrespect de la citation musicale, dont l’incongruité constitue un des ressorts du comique que l’on associe généralement aux Savoy Operas.
Meinhard Saremba étudie Haddon Hall, opéra de Sullivan sans Gilbert (le livret a été écrit par Sydney Grundy). La légende (forgée au début du XIXème siècle) de la fuite de Dorothy Vernon avec son amant a été transférée du XVIème siècle au XVIIème, pour créer un lien avec la lutte entre royalistes (les amants) et puritains (leurs adversaires). Parmi les admirateurs d’Oliver Cromwell, il y avait au XIXème siècle des propagateurs d’un nouveau puritanisme. Sullivan et Grundy, par contre, exaltent la « Merrie old England » ennemie de tout fanatisme. Saremba rejette l’interprétation de Michael Beckermann, qui oppose Haddon Hall – « iconique », c’est-à-dire statique, mélancolique, plutôt ennuyeux – au Mikado – « dialectique », c’est à dire dynamique, divertissant. Or, Haddon Hall n’est pas une comédie, mais une œuvre qui propage l’idéal d’un monde humain, où l’humour va de pair avec les aspirations sérieuses.
Dans la foulée des ouvrages de Sullivan, avec ou sans Gilbert, toute une série d’œuvres nouvelles virent le jour au tournant du XXème siècle, chacune expérimentant à sa manière de nouvelles voies, inspirées à des degrés divers de l’héritage du passé. Vincent Giroud s’intéresse ainsi à l’ouvrage de Sidney Jones The Geisha, un des rares ouvrages anglais à avoir eu un véritable succès à l’échelle internationale, presque comparable à celui de G&S. Dans son article l’auteur analyse ainsi les contextes historiques de l’œuvre, notamment à l’échelle de l’émergence toute récente du Japon sur la scène mondiale, ainsi que le subtil mélange d’éléments exotiques et patriotiques qui ne pouvait que satisfaire le public visé. Le texte pose le problème de l’emprise des contextes politiques et culturels sur la réception, la compréhension, la diffusion et la pérennité d’une œuvre dont un enregistrement relativement récent a révélé aussi les indéniables qualités musicales.
Lisa Evertz étudie (selon l’expression forgée par Théophile Gautier) un exemple d’exotisme dans le temps (The Arcadians) et deux d’exotisme dans l’espace (les japonaiseries The Geisha et The Mousmé). Elle souligne l’ambivalence du terme : les Européens sont fascinés par l’inconnu qu’ils méprisent en même temps, convaincus de la supériorité de la culture « moderne », occidentale. The Arcadians se réfère au mythe antique de l’âge d’or, révolu à jamais. L’Arcadie ne peut donc être qu’un monde poétique, artificiel, qui reflète la sphère, également artificielle, du théâtre. Le pays mythique présente en même temps une image déformée de la société anglaise et de ses problèmes inquiétants. Pour éclairer le statut de l’exotique, Lisa Evertz a recours au concept de « simulacre », défini par Baudrillard. Autour de 1900, la société japonaise est perçue d’une part comme prémoderne, sujette à des traditions millénaires ; d’autre part, on constate que, grâce à l’aide européenne et surtout anglaise, le pays est en train de se moderniser rapidement, processus qui fait peur aux colonisateurs, habitués pourtant à jeter sur le Japon un regard nostalgique qui n’était pas exempt de mépris. La modernité (c’est-à-dire la supériorité) de l’Angleterre vis-à-vis d’un monde exotique rétrograde permet aux femmes anglaises d’agir et de résister aux hommes, tandis que les Japonaises se résignent.. Dans les trois livrets étudiés, il y a des éléments propres à inquiéter les spectateurs, mais leur effet est atténué par l’ironie, qui leur rappelle constamment que tout cela n’est qu’un jeu.
Consacré lui aussi partiellement à The Arcadians, l’article de Claire Bardelmann analyse le corpus que constitue la comédie musicale édouardienne par rapport à la dette envers Shakespeare et l’univers élisabéthain, dont on sait à quel point ils étaient tous deux objet de fascination pour les Victoriens. L’auteur y démontre que si, paradoxalement, Shakespeare est absent de ce type de spectacle – du moins dans le sens où l’on ne trouve pas de comédie musicale directement adaptée du répertoire shakespearien –, l’influence du barde de Stratford se fait sentir à plusieurs niveaux, et tout particulièrement dans la manière dont la culture dite « savante » informe, alimente et influe sur des répertoires à visée plus directement « populaire ». Les comédies musicales de cette époque ont en effet comme dénominateur commun de montrer comment la présence shakespearienne nourrit l’imagination des Édouardiens, et contribue de ce fait à la création d’un « divertissement » qui n’est pas, tant s’en faut, dénué de ses lettres de noblesse.
Albert Gier relit trois des quatre pièces de Noël Coward qu’on peut qualifier d’« opérettes », dont deux sont faites sur mesure pour des vedettes (Yvonne Printemps, Fritzi Massary). Coward s’inscrit dans la tradition de l’opérette continentale, dont il respecte les conventions: Les livrets évoquent toujours le XIXème siècle ou l’époque édouardienne, âge d’or regardé avec un « particular mood of seminostalgic sentiment ». Bitter Sweet se termine en 1929, au temps du jazz et du charleston, peu sympathique à la protagoniste (et, sans doute, à l’auteur). Coward, quelques emprunts à des œuvres bien connues le prouvent, écrit toujours des opérettes sur l’opérette, il rend hommage à un genre qui a fait son temps ; la mélancolie est atténuée par l’ironie, élément essentiel de l’opérette de tous les temps. La fidélité au patron du genre est la cause du demi-échec d’Opérette: Fritzi Massary étant trop âgée pour jouer une ingénue, Coward invente pour elle un rôle épisodique, de façon qu’elle ne puisse pas se camper en vedette, bien qu’elle chante trois des plus importants numéros.
Sans doute située aux frontières génériques de notre objet d’étude, The Dance of Death, ouvrage issu de la compagnie théâtrale connue sous le nom de Group Theatre, fait l’objet de l’étude de Pierre Longuenesse. La pièce de W.H. Auden illustre ainsi à la perfection cette tendance moderniste qui réinvente, en lui donnant un nouvel éclairage politique, la comédie musicale traditionnelle. Un peu comme dans les ouvrages contemporains de Brecht et Weill, la poésie et la musique, le chant et la danse, deviennent ici des outils complémentaires permettant le mélange de formes lyriques ou épiques œuvrant toutes vers la création d’un spectacle d’art total dans lequel auteur, compositeur et chorégraphe jouent tous un rôle absolument essentiel et déterminant.
Si les années 50 et au-delà virent l’installation du genre de la comédie musicale dans l’univers commercial de Broadway et du West End, la deuxième moitié du XXème siècle fut également le théâtre d’expérimentations diverses et variées. Dans son étude d’un ouvrage américain de par la nationalité de ces auteurs, mais résolument britannique de par ses multiples sources ou de par son intrigue, Gilles Couderc commence par évoquer tout ce que la popularité de My Fair Lady doit au théâtre de George Bernard Shaw, qui a inspiré la pièce, et au film de George Cukor, que la comédie musicale a au contraire engendré. Décelant toutes les ambiguïtés d’un texte qui, depuis Ovide, n’a cessé d’être travaillé et retravaillé, notamment celles liées à un dénouement qui reste pour le moins problématique, l’article de Couderc démontre à quel point l’ouvrage d’Alan Jay Lerner et Frederick Loewe, qui doit aussi un peu à Oscar Wilde, se situe dans la filiation directe de la comédie musicale britannique, notamment dans ses liens avec l’univers de Gilbert et Sullivan.
Avec Jesus Christ Superstar, c’est l’univers d’Andrew Lloyd Webber qu’aborde Jean-Philippe Heberlé dans son analyse de l’hybridation générique causée par le recours à des formes musicales modernes comme le rock et l’opéra rock. Essentiellement consacrée à la genèse, à la réception et aux différentes versions de ce succès planétaire, lui aussi en grande partie dû à l’apport du cinéma, cette contribution étudie également la manière dont le texte biblique a été porté à la scène. À cheval entre culture savante et culture populaire, l’ouvrage de Lloyd Webber amorce une forme de révolution culturelle dans son mixage d’éléments disparates venus de mondes qu’on aurait pu croire antithétiques et irréconciliables. Sans doute est-ce une des spécificités de la comédie musicale que de rassembler, de façon parfois déroutante, des ingrédients aussi hétérogènes.
C’est également le but de la démonstration menée par Dorota Balilas que de souligner les mérites artistiques d’un autre ouvrage emblématique de Lloyd Webber, The Phantom of the Opera. Bien plus qu’un simple succès commercial ou qu’un réservoir de mélodies à succès lui aussi grandement « popularisé » par le cinéma, il s’agit ici d’une œuvre complexe, intimement mêlée aux contextes typiquement français du roman de Gaston Leroux, à l’opéra au sens le plus général, et plus particulièrement au grand opéra français du XIXème siècle dont le Palais-Garnier était autrefois le théâtre. L’article s’attache ainsi à retracer le réseau de liens qui unissent la réalisation de Lloyd Webber à différents genres musicaux, savants ou populaires. Sans doute est-ce un paradoxe que ce soit la comédie musicale qui, de par sa popularité, ait « rendu » au Fantôme son habitat naturel, le Paris du Palais-Garnier dont il était directement issu.
Changement d’univers, de ton et de problématique avec l’article de Danièle Berton-Charrière. Située dans l’Écosse des années 1950, l’histoire de The Steamie évoque en effet avec humour les difficultés sociales et économiques auxquelles sont confrontées quatre générations de femmes, toutes réunies dans une laverie collective. À nouveau confronté au phénomène de l’indétermination générique, cet ouvrage atypique peut revendiquer l’appellation de comédie musicale en raison de ses nombreuses racines, de son sous-texte et des multiples allusions au monde de la comédie musicale hollywoodienne dont se repaissent les protagonistes qui l’habitent. Comédie en musique sur la comédie musicale, ouvrage méta-théâtral cultivant l’autoréflexivité tout en menant à bien une réflexion sur les contextes sociaux de l’univers dont il est issu, The Steamie illustre une des pistes ouverte par les développements d’un genre musico-théâtral en perpétuelle évolution.
Lui aussi multi-générique, autoréflexif et empreint de connotations sociales, Billy Elliot fait l’objet de l’étude de Laurence Le Diagon-Jacquin. L’auteur y analyse le double parcours d’un jeune garçon épris de danse et de création artistique, ainsi que celui de son père confronté à une dure réalité sociale. Elle y démontre comment le thème de la « solidarité », particulièrement mis en valeur par les stratégies musicales mises en œuvre, est le fil conducteur d’un ouvrage qui dit les vertus d’une communauté ouvrière qui sait se sacrifier afin de privilégier le caractère exceptionnel d’une quête et d’un destin individuels. Ouvrage à la fois sur l’art et la société, l’histoire mise en scène dans Billy Elliot a su concilier classicisme et modernité, tout en suscitant une incroyable popularité.
Genre musical soumis à des problématiques esthétiques et sociétales en perpétuel renouvellement, la comédie musicale britannique continue depuis les premières années du XIXème siècle à faire la preuve de sa vitalité et de sa pérennité. Certes en proie aux lois économiques et mercatiques qui gouvernent Broadway et le West End, nourrie comme nous l’avons vu par ses liens avec le cinéma, elle n’a cessé au cours des siècles de développer des formes et des thématiques nouvelles, nourries à la fois des racines du passé et des contextes économiques et esthétiques des époques dont le genre est issu. Relevant d’une forme théâtrale à la fois savante et populaire, classique et moderne mais surtout éminemment vivante, elle continue et continuera sans doute longtemps à exercer son incroyable pouvoir de fascination.
Albert Gier et Pierre Degott
Préface

James Robinson Planché (1796–1880) was one of the most productive contributors to the musical theatre of 19th century London. His œuvre ranged from autonomous opera librettos to very free adaptations of French, German and Italian operas for the London stage, from melodramas to – most prominent – extravaganzas, a genre modelled after the French “Féerie Folie”, which Planché introduced to Britain and pursued for more than three decades. Two main forms of extravaganza were the classical one, dealing with subjects from the ancient mythology, and the fairy extravaganza on French fairy tales. Following the traditions of English musical theatre established in the 18th century, the extravaganza used pre-existing music as a basis for songs and choruses. To recognize the tunes sung on stage was one of the appeals of this kind of musical theatre.
The essay analyses the reservoirs of tunes used in the extravaganza and tries to retrace the shifts within these reservoirs and within the functions of the music for this genre.
Marion Linhardt


In 1868, a little all-singing, all-dancing, all-good-fun company from a small theatre in Liverpool, England, visited the United States. And there, in no time, they became the musical theatre sensation of the American age. Anybody who has read about the Victorian stage will know the name of Lydia Thompson. The Queen of Burlesque. A consummate actress, dancer, vocalist with enough star quality to power the Milky Way. Lydia was the bright, shining centrepiece of this little troupe, and she would go down in, in particular, the history of the American stage as such.
Strangely enough, no one had ever put down her story (and there was a wealth of it) in print, so when, a couple of decades ago, I was asked to put out a series of ‘Forgotten Stars of the Musical Theatre’ for Routledge, I thought it was time I did. Lydia was the subject of Volume I of the set. However, huge star that she was, Lydia couldn’t play her shows alone. She was accompanied across the Atlantic by four other performers, one male comedian and three singing-dancing ladies. Their names are rather less well-known. Singly. The girls would go down in history as ‘the British Blondes’. Pauline, Lisa and Ada. ‘The originals’. There would be others who followed – some who were more talented and more beautiful – but none who were more newsworthy and more sensational. So, twenty years on I thought that it was time that Pauline, Lisa and Ada got their due share of the historical limelight. Here they are: ‘the Blondes that never dyed’.
Kurt Gänzl


This paper aims at studying various dramatic, literary and musical strategies enabling Gilbert and Sullivan to turn their opera The Pirates of Penzance into more than a mere satire of pirate life. Not only do they gently ridicule the ridiculous code of honour of this band of aristocrats turned mock pirates; they also use, divert and make fun of some linguistic and vocal conventions then associated with Italian romantic operas, consequently acting as true “musical pirates”.
Joël Richard



With Haddon Hall Arthur Sullivan added a new facet to his wide-ranging operatic œuvre. The piece was labelled as an „Original Light English Opera“, a characterisation referring to the work’s original story and libretto as well as to its spoken dialogue. However, the passages of dialogue are comparatively slight, present between extended blocks of musical scenes that are connected by recitatives. The interaction is even used dramaturgically when after the arrival of the Puritans the music is more often interrupted by the spoken word. The libretto and the playbill included the information: “The clock of Time has been put forward a century, and other liberties have been taken with history” (the 16th-century legend of Dorothy Vernon’s elopement now takes place around 1660). This device was possible because the popular elopement story is not historical but had not been invented until the early 19th century and it offered the opportunity for topical allusions to the Cromwell cult in the 19th century and the rising influence of modern Puritan movements. Although Michael Beckerman’s analysis of iconic (Haddon Hall) and dialectic (The Mikado) modes offers useful tools for basic research, it is questionable if used to imply moral or qualitative values. Instead of labelling the differences as “standing still and moving forward” and subtly ascribing values such as “boring” and “entertaining”, it is appropriate to add to the definition and describe the iconic mode as epic in nature, where characters develop slowly through mutual compromise towards their identity (whereas the dialectic mode is focused on situations, offers woodcut-like characters and polarisation). The cultural, historical and political background of the plot reveals a modern portrait of its age due to the rising influence of women in society and criticism of moral values sermonized by Gladstone and Carlyle. The dynamics of the static are revealed in the subtle connections and allusions within the whole work, an entertaining interaction of comic and dramatic scenes as well as a sensitive portrayal of the protagonists. Sullivan’s Haddon Hall added to the justification of Edward Algernon Baughan’s statement: “The Savoy operas are our only national opera.” (Saturday Review, 8th October 1921)
Meinhard Saremba


Mentioned in Chekhov’s The Lady with the Little Dog and Joyce’s Ulysses, The Geisha by Sidney Jones, premiered at Daly’s Theater in 1896, was the first British musical to enjoy a considerable international success, far beyond the English-speaking world. The present contribution tries to account for this triumph from a historical perspective (the rise of Japan’s status following its victory against China) and a cultural standpoint (fascination with the Japanese woman in the wake of Pierre Loti’s Madame Chrysanthème). It discusses the clever mix of exotic and patriotic elements, designed to appeal to middle-brow Western audiences, and the few nods at Japanese music in Jones’s otherwise traditional score. The gradual disappearance of the work from the repertory after the First World War is explained by changes both in the historical context and by a different image of the Japan in Western culture, especially after the sensational success of Puccini’s Madam Butterfly.
Vincent Giroud

In the so-called Edwardian Musical Comedies created at the turn of the twentieth century in Great-Britain, the exotic is a recurrent topic, which can be related either to an exotic time or an exotic space. In The Arcadians, which deal with the subject of the Golden Age, the shepherds and shepherdesses of Arcady have been living in an exotic ancient world standing still for ages for being confronted now with the technical and moral changes of modernity represented by a couple of Londoners. The librettos of The Geisha and The Mousmé localize their plots in the exotic land of Japan, contributing to the contemporary Western fascination with an exoticised Japan, where beautiful geishas and quaint customs are supposed to satisfy the imagination of an urban public. As – following Edward Said’s Foucault-based theory of Western orientalism – the representation of the exotic tells more about the British society and its concerns than about the exoticised other, the librettos reveal a lot of the desires and fears of the Western population facing modernity at the end of the 19th century. In this sense, The Arcadians prove to be sort of a key work, using the topos of the Arcadian Golden Age, which is traditionally linked with poetical self-reflexivity, for questioning the aims and the performance of musical theatre and reclaiming its adaptation to a modern urban society. A similar meta-level characterizes the two musical comedies playing in Japan, which equally reflect and discuss some of the prevalent concerns of the British society of that time, including consumerism, changing gender roles and imperialism.

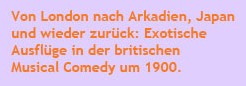
Liza Evertz
Shakespeare’s presence in Edwardian musical comedies is a paradox. Only a few are based on the work of the Bard, and even fewer display direct references to his plays, in an apparent contrast with the widespread bardolatry of the Victorian age. However, Shakespeare remains a cultural model whose presence is everywhere felt in musical comedies. His burlesque appropriations by stalwart figures of the Edwardian scene, like Oscar Asche, are central in bridging the gap between highbrow and lowbrow cultures in a context of changing patterns of audience demand and response. In musical comedies, the description of social anxieties linked to the emerging status of women, and the changing world of modernity, also hinges on the appropriation of Shakespeare as an agent of cultural transmutation. Musical comedies show Shakespeare’s diffuse but powerful presence in the Edwardian imagination, and pinpoint its esthetic contribution at a formative moment in the history of popular entertainment.

Claire Bardelmann
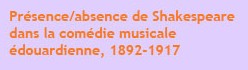
Placez le curseur sur les flèches pour afficher les titres.